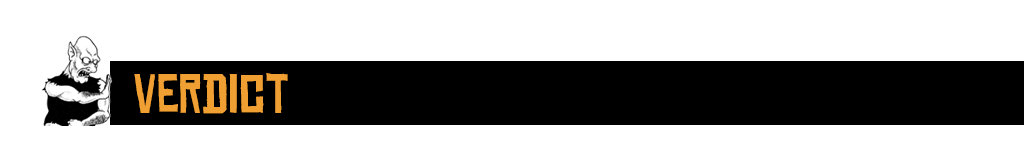Frankenstein, ça se lit encore!
Lorsque j’ai eu l’idée, il y a quelques temps, de lire Frankenstein, je pensais m’emmerder un peu, voire beaucoup… Mais bon, en tant que fan de S-F et de fantastique, je me disais qu’il était temps de combler mes lacunes concernant l’histoire du/des genres. Il faut dire que la célébrité et les déformations qui vont avec n’aident pas. À regarder la date de l’œuvre de Mary Shelley, 1818, tout en ayant en tête les images et les représentations d’un inconscient collectif propice à la caricature, je partais du principe que j’aurais en face de moi un truc au style vieillot et peu engageant. Vous savez, ce genre d’œuvre qui sont au fond des grosses daubes mais à propos desquelles un gentil monsieur à lunettes sort de sous le bureau et vous dit « ah oui, mais resitué dans son époque et son contexte »… l’argument imparable par excellence. Cela d’autant plus que je venais d’achever ce qui est considéré comme étant le premier roman gothique, Le château d’Otrante d’Horace Walpole, qui m’avait profondément déçu…
Je vous épargne les quelques phrases du type faussement surpris et passe directement à la conclusion : Frankenstein, ça se lit encore aujourd’hui et plutôt deux fois qu’une.
Une histoire simple… enfin presque
Alors bon, bien sûr, l’histoire résumée ne fait pas forcément rêver. Nous suivons les pérégrinations du jeune bourgeois Victor Frankenstein depuis sa prime enfance jusqu’au moment où, détenteur d’un savoir inédit, il parvient à créer un semblant d’être humain à partir de bouts de cadavres. S’ensuit alors, grosso merdo, le récit de la lutte entre « le monstre » et Victor. Si nous en restons là, vous vous direz que, comme l’auteur d’un article pour tabloïd à la con, je vous ai enfumé.
Sauf qu’il faut bien comprendre que Frankenstein est un roman épistolaire composé en réalité de trois trames narratives différentes, toutes racontées à la première personne. La première est le récit de Waldon, une sorte d’explorateur perdu dans le pôle nord. C’est lui qui rencontre un Frankenstein à moitié mort, hébété mais qui parvient finalement à nous raconter son épopée. Enfin, et désolé pour l’énumération, le personnage principal fait parler sa créature au milieu de son histoire, ce qui nous fait donc une troisième aventure. Ouf.
|
Histoire 1 : Waldon
|
En général, c’est à ce moment là que l’on se dit que ce n’est plus si simple. Ce système de poupées russes, ou de récit métadiégétique dans le récit métadiégétique pour les cuistres, fournit à mon sens une grande partie de l’intérêt de Frankenstein. En effet, il participe d’une part à casser la monotonie du récit : le changement des points de vue est plus que rafraîchissant. D’autre part, sur le fond, il nous permet de nous poser quelques questions, voire de se faire franchement mal à la tête. Mais n’allons pas trop vite. ( « Patience, patience mon trésor »…. comme dirait l’autre).
Une ambiance gothique à souhait (Non je ne vous parle pas des adolescents prépubères avec des faux piercings et des salopettes noires)

« Évidemment » me diront certains, étant donné que Frankenstein est considéré comme l’apogée du roman gothique. Mais il faut insister là dessus car tout y est, et de fort belle manière. Shelley nous plonge en effet dans une atmosphère sombre et glacée particulièrement appréciable. Clair de lune, forêts profondes, montagnes solitaires et enneigées nous accompagneront durant toute notre lecture car l’histoire se déroule principalement dans les Alpes et au Pôle Nord. Et lorsque l’auteure nous en éloigne, c’est pour nous amener aux Orcades, à savoir un archipel écossais aux rivages accores, abrasés par le vent et la pluie. Frankenstein développe donc une esthétique romantique du sublime qui fonctionne encore très bien, même pour nous lecteurs du XXIème siècle.
On ne peut que remarquer les affinités entre les paysages décrits et certains tableaux de C. D. Friedrich : « Les flancs abrupts d’immenses montagnes se dressaient devant moi ; le mur gelé du glacier me surplombait ; on voyait ça et là quelques sapins fracassés ; et le silence solennel de cette glorieuse salle du trône d’une Nature impériale n’était troublé que par le bruissement de l’eau du torrent, par la chute de quelque immense bloc, le tonnerre de l’avalanche ou les craquements, qui résonnaient le long des montagnes, de la glace accumulée […] Ce paysage sublime et magnifique me procurait la plus grande consolation que j’étais en état de recevoir » (chapitre 10 § 1). Le style, emphatique, amène souvent le « grandiose et terrible » caractéristique de l’œuvre.
Je dois cependant souligner – certains voudront me tuer – qu’il est parfois plutôt casse-burnes lorsqu’il sert les développements lyriques du narrateur. Frankenstein a clairement quelques longueurs, probablement inévitables, car comme dirait le monsieur à lunettes de sous le bureau : « replacé dans son contexte »… Il n’empêche que la plupart du temps, on est saisi par la modernité du « je » et des portraits psychologiques des personnages. Enfin, dernier aspect de l’ambiance, le morbide, inhérent à l’histoire même et à la source duquel le lecteur bienveillant puisera tout un questionnement sur la fine frontière en vie et mort, participe naturellement à faire de Frankenstein le summum du roman gothique.
Le monstre, personnage génial
 Pauvre monstre!… Ou pas … C’est là l’intérêt de l’œuvre de Shelley
Pauvre monstre!… Ou pas … C’est là l’intérêt de l’œuvre de Shelley
Le plus gros coup de génie de M. Shelley reste peut-être la création du monstre. Il n’a rien d’une brute épaisse stupidement mauvaise ou de ce genre :
« – Mais quand même, pourquoi il veut détruire le monde, Sauron, Papa ?
– Ah mon fils, tu vois Sauron, c’est la personnification d’un mal rampant, métaphysique, il n’a pas besoin de but…
– Quoi ??
– Non, bon en vrai personne en sait rien… peut-être qu’un camarade lui piquait ses jouets quand il était petit ».
Frankenstein évite tout manichéisme simpliste et c’est là sa grande force. En réalité, la créature, d’une intelligence prodigieuse, ne cesse de défendre sa cause au cours de son récit… Elle explique sa cruauté par le rejet des Hommes, réflexion éminemment Rousseauiste sur l’origine du mal. Les immondes ! On ne peut s’empêcher, face à ce récit à la première personne du monstre, de le prendre en pitié.
Loin d’être un artifice littéraire, le récit enchâssé développe et renforce l’empathie que nous ressentons vis à vis de « l’erreur » de Victor : « Crois moi, Frankenstein : j’étais bienveillant ; mon âme rayonnait d’amour et d’humanité. Mais ne suis-je point seul – seul et misérable ? Toi, mon créateur, tu me détestes ; que puis-je espérer de tes semblables qui ne me doivent rien ? […] Montagnes désertiques et mornes glaciers sont mon refuge. […] je salue ces tristes cieux, car ils me montrent plus de bonté que tes semblables ». ( chapitre 10).
Le tour de force ne s’arrête pas là. L’enchâssement amène un autre intérêt : il implique qu’aucune instance externe, objective, comme un narrateur omniscient, ne garantisse la véracité de l’histoire du monstre. Ce dernier dit-il la vérité ? Ou alors est-il par essence porté vers la tromperie et le vice ? De fil en aiguille, nous en sommes amenés à douter des histoires de chacun des protagonistes. Peut-être que Victor accentue les méfaits du monstre dans la suite de son récit afin de se dédouaner… Frankenstein parvient à renverser nos repères jusqu’à ce que disparaisse toute vérité. Nous ne sommes alors pas si loin de la réflexion d’un Kurosawa dans Rashomon par exemple, avec une multiplicité des récits qui perd le spectateur.
Un roman inépuisable, comme tout bon chef-d’œuvre
Vous l’aurez compris, Frankenstein nous fait réfléchir. Je ne ferai pas le catalogue des pistes de réflexion qu’il initie, car ce n’est ni souhaitable (c’est même profondément chiant pour vous), ni faisable. Simplement, j’évoque rapidement quelques éléments. Bien sûr, l’œuvre est une réflexion sur la science et ses déboires, et plus fondamentalement, semble montrer les limites d’une raison toute puissante, plaçant ainsi Shelley dans le camp des anti-lumières. Le livre est ainsi sous-titré « Frankenstein ou le Prométhée moderne ». Les dimensions Prométhéenne et Faustienne s’entrelacent d’ailleurs (s’enlacent même) sans cesse. Dans les éléments à retenir, on peut aussi évoquer les références à la religion, avec une reprise du pêché originel via le savoir acquis par Victor, ou encore la thématique des limites du langage, non pas vecteur de communication, mais éventuellement de tromperie avec le récit de la créature…
Bref, Frankenstein est extrêmement riche en références, se positionnant à la fois comme une reprise des mythes originels et l’initiateur de nouvelles thématiques.
Cependant, et surtout, cette épaisseur n’occulte pas le plaisir du lecteur du dimanche. Pas de masturbation intellectuelle type Nouveau Roman ici, mais bien, somme toute, un bon gros récit gothique avec ses morts scabreuses, ses frissons, et ses jeunes filles inutiles qui finissent par y passer. L’essentiel est là : le plaisir de l’évasion.
 Pourquoi écrire un article sur Frankenstein alors que des vieux messieurs bien plus compétents que moi l’ont maintes fois décortiqué ? C’est sans doute pour dire à ceux qui lisent de la fantasy ou de la S-F actuelle, et sont plongés dans La compagnie noire suivant les conseils de notre rédac’ en chef, que les vieux romans ont du bon. Non pas parce que des tas de professeurs excités font l’éloge d’un « classique » sublime et échafaudent des théories plus ou moins farfelues, mais parce que concrètement, Frankenstein est un roman qui ne nous lâche pas et réciproquement. En d’autres termes, pas besoin d’être un cacique de littérature pour l’apprécier, au contraire : Foncez !
Pourquoi écrire un article sur Frankenstein alors que des vieux messieurs bien plus compétents que moi l’ont maintes fois décortiqué ? C’est sans doute pour dire à ceux qui lisent de la fantasy ou de la S-F actuelle, et sont plongés dans La compagnie noire suivant les conseils de notre rédac’ en chef, que les vieux romans ont du bon. Non pas parce que des tas de professeurs excités font l’éloge d’un « classique » sublime et échafaudent des théories plus ou moins farfelues, mais parce que concrètement, Frankenstein est un roman qui ne nous lâche pas et réciproquement. En d’autres termes, pas besoin d’être un cacique de littérature pour l’apprécier, au contraire : Foncez !
P.S : Si j’ai offensé les messieurs à lunettes, je m’en excuse.